| MERCURE |
par Gérard OUDENOT |
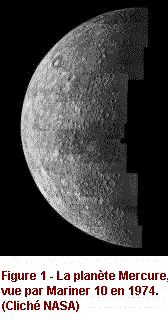 Mercure
est l’une des cinq planètes visibles à l’œil
nu (fig. 1), elle a donc été remarquée
depuis la plus haute antiquité. Les grecs l’appelaient
Hermes, le “messager des dieux”, à cause
de son déplacement rapide dans le ciel et pour les
romains, qui lui ont donné le nom de “Mercure”,
c’était le dieu du commerce, des voyages et
des voleurs ! Mercure
est l’une des cinq planètes visibles à l’œil
nu (fig. 1), elle a donc été remarquée
depuis la plus haute antiquité. Les grecs l’appelaient
Hermes, le “messager des dieux”, à cause
de son déplacement rapide dans le ciel et pour les
romains, qui lui ont donné le nom de “Mercure”,
c’était le dieu du commerce, des voyages et
des voleurs !
Mercure est une petite planète de 4 880 km de diamètre,
qui accomplit sa révolution autour du Soleil en 88
jours. Son déplacement rapide dans le Système
solaire est dû à sa proximité du Soleil.
La planète en est distante en moyenne de 58 millions
de kilomètres, mais peut s’en rapprocher jusqu’à 46
millions de kilomètres ou s’en éloigner
jusqu’à 70 millions de kilomètres. Ce
qui signifie que son excentricité (rapport entre la
distance du Soleil au centre de l’ellipse orbitale
et sa distance moyenne à la planète) est élevée
: 0,206 ; c'est la plus élevée pour les planètes
du Système solaire, exceptée celle de Pluton.
Mercure se déplace dans le ciel et revient en face
du Soleil tous les 115 jours, c’est sa révolution
synodique, déjà mesurée avec précision
par l’astronome grec Eudoxe, au quatrième siècle
avant notre ère. Plus proche du Soleil que la Terre,
il ne s'en éloigne jamais angulairement de plus de
28° (fig. 2)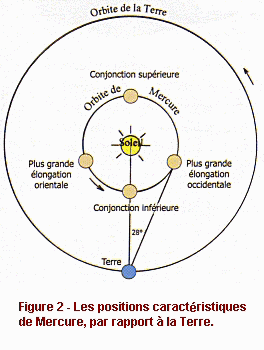 . Ce corps, déjà petit en taille,
reste ainsi toujours placé dans les lueurs du crépuscule,
lorsqu'il n'est pas invisible ; ce qui explique pourquoi
on savait si peu de choses sur cette planète avant
que la sonde spatiale américaine Mariner 10 ne la
survole. . Ce corps, déjà petit en taille,
reste ainsi toujours placé dans les lueurs du crépuscule,
lorsqu'il n'est pas invisible ; ce qui explique pourquoi
on savait si peu de choses sur cette planète avant
que la sonde spatiale américaine Mariner 10 ne la
survole.
Ceci implique également un système de phases,
tout comme pour la Lune, où l’éclat maximal
correspond au “plein Mercure” et chute rapidement.
De plus, Mercure ne peut pas s’observer dans les feux
du Soleil, il faut attendre qu’il en soit éloigné,
ce qui ajoute aux difficultés d’observation.
Les phases ne sont pas visibles à l’œil
nu ; elles n’ont pas été vues non plus
par Galilée dont la lunette n’était pas
assez puissante ; c’est l’astronome italien Giovanni
Zupus, qui les a observées le premier, en 1639.
Contrairement à ce qu'on pensait depuis Schiaparelli
en 1889 et jusqu’en 1962, Mercure ne présente
pas toujours la même face au Soleil, mais tourne sur
lui-même en 59 jours. On remarque que 59 x 3 est voisin
de 88 x 2. Ce qui n'est pas un hasard : Mercure fait trois
tours sur lui-même pendant qu'il en fait deux autour
du Soleil. Nous nous trouvons comme pour la Lune par rapport à la
Terre, devant un couplage mécanique. Mais celui-ci
est plus complexe ; il ne peut s'exercer que sur une planète
d'excentricité élevée, ce qui est le
cas ici, et c’est d’ailleurs le seul exemple
de ce type de couplage dans le Système solaire.
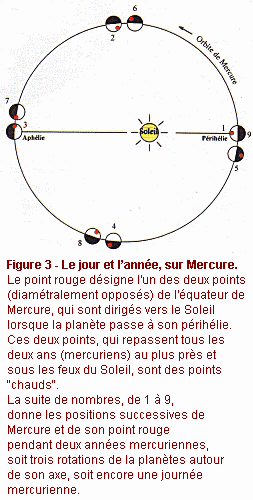 Ceci a des conséquences curieuses, dont l’une
des plus banales est que la journée sur Mercure (qui
dure 176 de nos jours) dure en fait deux ans mercuriens,
qui valent 2 x 88 j (fig. 3). Ceci a des conséquences curieuses, dont l’une
des plus banales est que la journée sur Mercure (qui
dure 176 de nos jours) dure en fait deux ans mercuriens,
qui valent 2 x 88 j (fig. 3).
La masse de Mercure a été longtemps difficile à évaluer,
car la planète ne possède pas de satellite,
et sa petite masse ne cause que de faibles perturbations à ses
voisines. C’est Johann Encke qui en fit la première
détermination expérimentale, en 1841, en mesurant
les perturbations que Mercure exerçait sur la comète
qui allait porter son nom. Cette valeur était bonne à 20%.
Plus proche de nous, la sonde Mariner 10 a permis, en 1974,
de fixer la masse de Mercure à 0,055 masse terrestre
ou 3,302.1023 kg.
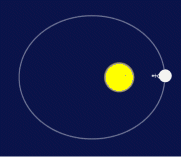 La densité moyenne de Mercure est de 5,44, ce qui
est beaucoup pour une planète aussi petite. Presque
autant que la densité de la Terre qui est de 5,52.
En réalité c’est même plus que
cela ; comme nous venons de le dire la Terre est bien plus
massive que Mercure et ses couches extérieures exercent
une pression élevée sur ses parties centrales,
ce qui conduit à une densité “non comprimée” de
4,45, contre 5,3 pour Mercure ; c’est la plus forte
du Système solaire. Il en résulte que le noyau
ferreux de Mercure doit-être très important
: de l’ordre de 1 800 km de rayon. Ceci suggère
que cette planète ne s’est pas formée
seulement par accrétion à partir de la nébuleuse
primitive. Proche du Soleil elle a récupéré les éléments
les plus denses de la nébuleuse, mais de plus elle
a connu une naissance cataclysmique, analogue à celle
de la Lune : un proto-Mercure, 2,25 fois plus massif que
le Mercure actuel, a été heurté par
un gros astéroïde primordial d’une masse égale à 1/6
de celle du proto-Mercure. Les éléments les
plus légers ont été éjectés,
sans former un satellite comme ce fut le cas pour la Lune
; il en est résulté la planète dense
que nous connaissons, composée essentiellement du
noyau ferreux dont nous avons déjà parlé,
entouré d’une coquille silicatée d’environ
600 km d’épaisseur, analogue à l’ensemble
manteau plus croûte terrestres. La densité moyenne de Mercure est de 5,44, ce qui
est beaucoup pour une planète aussi petite. Presque
autant que la densité de la Terre qui est de 5,52.
En réalité c’est même plus que
cela ; comme nous venons de le dire la Terre est bien plus
massive que Mercure et ses couches extérieures exercent
une pression élevée sur ses parties centrales,
ce qui conduit à une densité “non comprimée” de
4,45, contre 5,3 pour Mercure ; c’est la plus forte
du Système solaire. Il en résulte que le noyau
ferreux de Mercure doit-être très important
: de l’ordre de 1 800 km de rayon. Ceci suggère
que cette planète ne s’est pas formée
seulement par accrétion à partir de la nébuleuse
primitive. Proche du Soleil elle a récupéré les éléments
les plus denses de la nébuleuse, mais de plus elle
a connu une naissance cataclysmique, analogue à celle
de la Lune : un proto-Mercure, 2,25 fois plus massif que
le Mercure actuel, a été heurté par
un gros astéroïde primordial d’une masse égale à 1/6
de celle du proto-Mercure. Les éléments les
plus légers ont été éjectés,
sans former un satellite comme ce fut le cas pour la Lune
; il en est résulté la planète dense
que nous connaissons, composée essentiellement du
noyau ferreux dont nous avons déjà parlé,
entouré d’une coquille silicatée d’environ
600 km d’épaisseur, analogue à l’ensemble
manteau plus croûte terrestres.
Mercure n'a pas d'atmosphère. Le peu de gaz qu'il
a peut-être récupéré lors de sa
formation s'est dissipé rapidement dans l'espace,
en particulier si l'hypothèse de la formation par
collision est la bonne. Mariner 10 a mesuré avec précision
la pression au sol : 10-12 atmosphère (soit 10-9 hectopascal),
mille milliards de fois moins que sur la Terre, c'est-à-dire
vraiment rien ! L’”atmosphère” consiste
en atomes de la surface de Mercure éjectés
par le vent solaire.
Du fait de la proximité du Soleil et de l'absence
d'atmosphère, il existe de fortes différences
de température au niveau du sol de Mercure. À midi,
la température atteint 400°C à l'équateur,
tandis qu'elle descend jusqu'à - 200°C seulement
sur la partie non éclairée.
Les trois survols de Mercure par Mariner 10, en 1974-75,
nous ont révélé un peu moins de la moitié de
sa surface. Le sol est criblé de cratères qui
sont essentiellement le résultat de la chute des météoroïdes
primordiaux, c'est-à-dire les débris qui n'avaient
pas servi à fabriquer des planètes et qui ont
percuté ces planètes pendant environ 500 millions
d'années. Le relief de Mercure ressemble beaucoup à celui
de la Lune dans son ensemble, mais s’en éloigne
dans les détails. On y trouve un grand nombre de cratères
qui, comme ceux de la Lune, ont des structures liées à leur
taille. Les plus petits, jusqu’à une vingtaine
de kilomètres de diamètre, ont la forme d’un
bol ; de 20 à 100 km ils présentent la plupart
du temps un piton central ou plusieurs pour les plus grands,
et au-dessus de 150 km, on y voit un ou plusieurs anneaux
concentriques. La profondeur des cratères est de l’ordre
du dixième de leur diamètre, avec une profondeur
maximale de 2 km. Comme dans le cas de la Lune, ces formes
particulières sont dues aux déformations et
reconfigurations du sous-sol, au moment de l’impact
qui a donné naissance au cratère. Les cratères
de Mercure présentent la particularité d’être
plus regroupés que sur la Lune : à des zones
très cratérisées succèdent des
plaines lisses, dites inter-cratères. L’explication
en est simple, la gravité sur Mercure est à peu
près égale au double de celle de la Lune, aussi
lorsqu’un météoroïde tombe et forme
un cratère, les débris éjectés,
qui forment à leur tour d’autres cratères,
retombent plus près.
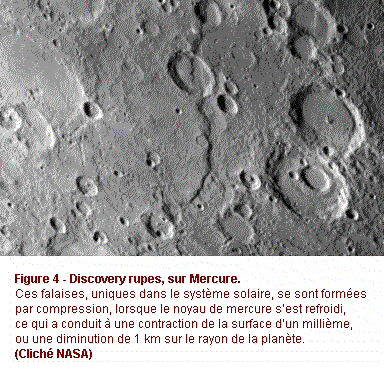 Une autre des particularités de Mercure, qu’on
ne retrouve sur aucune autre planète, consiste en
de vastes falaises ou escarpements lobés, qui peuvent
s’étendre sur des centaines de kilomètres
(fig. 4). Désignés sur les cartes par leur
nom latin de « rupes », ils correspondent à une
contraction de la planète lors de son refroidissement.
Les escarpements lobés traversent des cratères,
comme on le voit bien sur la figure 4, ce qui suppose une
formation postérieure à celle des cratères.
Leur orientation amène à penser qu’ils
ont été influencés par la chute d’un énorme
météoroïde à l’origine d’un
vaste bassin : le bassin de la chaleur. Une autre des particularités de Mercure, qu’on
ne retrouve sur aucune autre planète, consiste en
de vastes falaises ou escarpements lobés, qui peuvent
s’étendre sur des centaines de kilomètres
(fig. 4). Désignés sur les cartes par leur
nom latin de « rupes », ils correspondent à une
contraction de la planète lors de son refroidissement.
Les escarpements lobés traversent des cratères,
comme on le voit bien sur la figure 4, ce qui suppose une
formation postérieure à celle des cratères.
Leur orientation amène à penser qu’ils
ont été influencés par la chute d’un énorme
météoroïde à l’origine d’un
vaste bassin : le bassin de la chaleur.
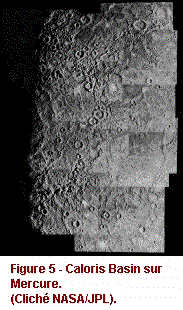
Le bassin de la chaleur (fig. 5), de son nom latin usuel « Caloris
Basin », mesure 1 300 km de diamètre et tire
son nom du fait qu’il correspond à l’un
des deux points « chauds » de Mercure. Ce qui
signifie que, compte tenu du rapport particulier entre sa
rotation et sa révolution, Mercure à son périhélie
présente toujours les deux mêmes points de sa
surface, qui sont donc les points les plus chauds. La formation
de Caloris Basin, il y a 3,8 milliards d’années
a réactivé brièvement le volcanisme
et orienté les figures de compression de la planète.
L’onde de choc produite par l’impact a également
déchiquetée les terrains situés aux
antipodes de Caloris Basin (fig. 6).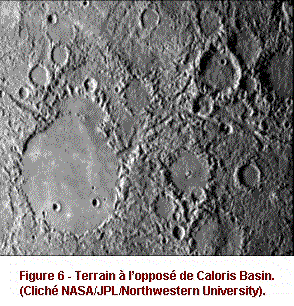 Il semble que ceci marque
le seul épisode important dans la vie de Mercure depuis
la naissance du Système solaire ; ensuite il n’a
plus connu qu’un lent refroidissement, si l’on
peut associer l’idée de refroidissement à une
planète aussi chaude ! Il semble que ceci marque
le seul épisode important dans la vie de Mercure depuis
la naissance du Système solaire ; ensuite il n’a
plus connu qu’un lent refroidissement, si l’on
peut associer l’idée de refroidissement à une
planète aussi chaude !
En 1991 et 1992, des observations en radarastronomie ont
montré qu'il pourrait exister de la glace au niveau
des calottes polaires de Mercure. Une vingtaine de glaciers,
de quinze à soixante kilomètres de diamètre,
ont pu être associés à des cratères.
C'est le pôle sud qui détient le record avec
un bloc de glace de 130 km de diamètre dans le cratère
Chao Meng-fu (fig. 7).
Ces glaciers très vraisemblablement
composés d'eau, doivent avoir une épaisseur
largement supérieure au mètre. Ils ont pu persister
depuis plusieurs milliards d'années grâce au
relief tourmenté de Mercure. L'axe de rotation de
la planète étant perpendiculaire à son
orbite, la lumière ne pénètre jamais à l'intérieur
des cratères proches des pôles, et la température
n'y dépasse pas -170°C, ce qui est suffisant pour
empêcher la sublimation de la glace. La présence
de poussière au sein des glaciers et en surface pourrait également
aider à éviter l'évaporation.
L’axe magnétique de Mercure est orienté dans
le même sens que celui de la Terre et fait un angle
presque identique (11°) avec l’axe de rotation.
La valeur du champ à la surface de la planète
est le centième de celle de la Terre (environ 5.10-7
tesla). La distance moyenne du centre de la planète à la
magnétopause est de 1,5 rayon planétaire, tandis
que pour la Terre elle est de 11 rayons planétaires.
Il en résulte que le vent solaire atteint beaucoup
plus facilement la surface de Mercure et qu’il n’existe
pas de ceintures de radiations, comme les ceintures de Van
Allen autour de la Terre.
Mariner 10 est la seule sonde spatiale à s'être
approchée de Mercure jusqu'à aujourd'hui. Deux
nouvelles missions sont actuellement prévues : "Messenger" et "BepiColombo".
Messenger (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry
and Ranging) est une mission de la NASA qui devrait être
lancée au début de 2004 pour placer un satellite
en orbite autour de Mercure en avril 2009 pour une durée
d’un an terrestre. La mission BepiColombo, du nom du
scientifique italien Giuseppe (Bepi) Colombo qui avait proposé la
trajectoire de Mariner 10, est une mission de l'ESA, avec
la participation de l'ISAS (Institut de l'espace et des sciences
astronautiques du Japon). La mission devrait être lancée
en 2009 et atteindre Mercure deux ans et demi plus tard ;
alors deux engins spatiaux seraient mis en orbite autour
de Mercure et un troisième se poserait sur le sol
de la planète.
|

